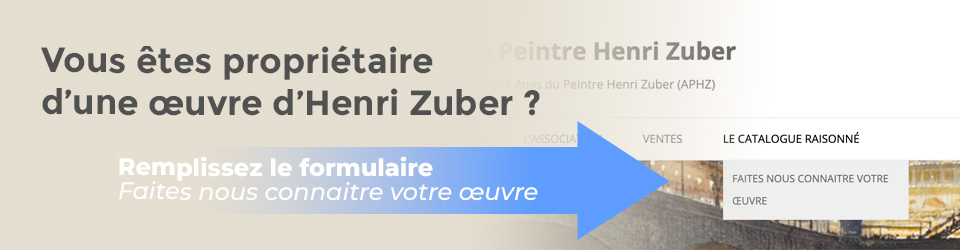PARIS, 1870-1900 Le Paris de la Guerre de 70, du siège de la ville et de la Commune, c’est aussi celui d’un fabuleux essor technique : fière de sa primauté, la capitale organise d’extraordinaires expositions, symbole de la puissance et de la richesse de la France. Les travaux d’aménagement, commencés par le Baron Haussmann, transforment la ville en un immense chantier, on construit, on plante, on creuse : la ville lumière prouve son inépuisable vitalité. C’est dans ce Paris-là qu’Henri ZUBER établit son domicile et installe son atelier, rue de Vaugirard, puis quelques années plus tard, rue Vavin.Tout en donnant à ses œuvres ce charme particulier qu’il tire du traitement de la lumière, il sera un témoin attentif des transformations de la ville. A ce sujet, ses tableaux de Paris sont autant de repères qu’il convient de souligner et de mettre en valeur, car ils fixent une époque disparue et des lieux qui nous parlent. R. G.
L’apprentissage : La formation au métier de peintre
Henri ZUBER a baigné dès son enfance, dans l’atmosphère artistique de la Manufacture de papiers peints de son père Jean ZUBER, où le peintre EHRMANN lui apprend à dessiner.
Quelques années plus tard, tout en préparant l’École Navale Impériale à Paris, il est probable qu’il participe aux cours du soir de quelque académie parisienne. Très jeune, il montre des dispositions étonnantes pour le dessin et l’on sait qu’il devint l’élève du paysagiste suisse Léon Berthoud (1822-1892), lui-même ancien élève de Coignet.
En 1868, quand commence la carrière de peintre d’Henri ZUBER, Léon Berthoud demande au critique Charles Clément de recommander à Charles GLEYRE un jeune ami et ancien élève, Henri ZUBER, qui désire entrer dans son atelier. L’Ecole des Beaux-Arts, placée sous le contrôle de l’Institut de France, était la voie d’accès à toute carrière d’artiste tant soit peu respectable. Une fois inscrit, on entrait dans un atelier que dirigeait un artiste académique.
Tel était le célèbre atelier de Charles Gleyre où Zuber travailla avidement. Il est probable qu’il ne retint de l’enseignement du Maître que les recettes du métier. En effet, à la mort de Gleyre, il écrit le 11 mai 1874 : « Sans doute M. GLEYRE était un Maître fort insuffisant au point de vue du métier, et il était difficile de tirer de lui une méthode fixe qu’il ne possédait pas lui-même. Mais il savait dire des mots qui restent gravés dans la mémoire et qui font réfléchir … »
Les progrès du jeune élève sont rapides puisque dès l’année 1869 il est admis à exposer au « Salon » où deux oeuvres sont présentées « La rue de Pékin » et « La tour de Porcelaine au Palais d’été ». Il quittera lui-même son maître, auquel il portait une réelle affection. à la déclaration de guerre de 1870. D.B.
LE PIED DE MONET
Henri Zuber ne rencontrera pas, dans l’atelier de Gleyre, Renoir, Monet et Sisley qui viennent de le quitter. Pendant la séance de modèles, raconte Monet, Gleyre passait d’un chevalet à l’autre pour corriger le travail de l’élève.
Un jour, Monet avait dessiné le modèle tel qu’il le voyait, avec un pied énorme. Gleyre l’apostropha : « Rappelez-vous, jeune homme, que lorsqu’on exécute une figure, il faut toujours penser à l’antique. La nature, mon ami, n’est bien que comme élément d’étude, seul compte le style, c’est-à-dire l’art d’idéaliser le vrai, de simplifier le spectacle de la nature et de lui conférer la dignité ».
Quelque temps plus tard, Monet quittera l’atelier de Gleyre avec cette phrase célèbre « Filons d’ici, l’endroit est malsain, on y manque de sincérité ». D. B.

LA VIE PARISIENNE
Le Paris du dernier tiers du XIXe siècle était gai, actif et plein de vie. Malgré l’énorme indemnité de guerre exigée par la Prusse, la France se releva avec une rapidité stupéfiante.
La transformation commencée sous Napoléon III se poursuit selon les vues du baron Haussmann. L’Opéra, inauguré en 1875, devient un nouveau pôle de la vie parisienne.
Degas vient applaudir Miss La La au cirque Fernando, Renoir peint le Moulin de la Galette et un peu plus tard, Toulouse-Lautrec fixe sur la toile les célèbres compositions de Nini-Patte-en-l’air et de la Goulue.
A cette agitation, Henri Zuber, par nature et par goût, préfère surprendre les secrets de la nature et saisir les fugitives impressions des paysages où règne une douce intimité : un crépuscule d’octobre, des promeneurs attardés, lents et silencieux, foulant les feuilles mortes, une matinée d’avril claire, argentée et fraîche.
Il peint des harmonies simples, exquises, parfois mélancoliques, qui invitent à la rêverie. D.B
LA MARIE JEANNE
Le 3 octobre 1868, Henri ZUBER démissionne de la Marine et s’installe à Paris. Peu de temps après, éclate la Guerre de 1870. Il s’engage aussitôt et sert d’abord au fort d’Ivry, très exposé, puis au Mont Valérien où il prend le commandement de la batterie de marine « de 24“ baptisée La Marie Jeanne qui fit « beaucoup de mal aux Prussiens ».
Après la défaite, La Marie Jeanne, tirée par 65 chevaux, fut descendue du Mont Valérien et conduite solennellement vers un wagon spécial à destination de Berlin. Trois régiments de la Garde assistaient à son départ, les tambours battaient « au champ » et la musique jouait la marche nationale.
La Marie Jeanne fut restituée en 1921 en vertu du traité de Versailles et placée au Musée de l’Armée. En 1940, elle fut de nouveau enlevée par les Allemands, restituée en 1947 par les autorités soviétiques et placée dans la Cour d’Honneur des Invalides où elle se trouve toujours.
La Marine l’appelait « La Marie Jeanne », le Musée de l’Armée « La belle Joséphine » et les Allemands « Catharina de la Faule Grethe » (Lettre du Général d’Avout d’Auerstaedt du 27/02/1974). D.B.
LES AQUARELLES DE PARIS
 D’HENRI ZUBER
D’HENRI ZUBER
Il est difficile de se faire une idée de l’importance relative des aquarelles de Paris par rapport à la totalité de l’œuvre aquarellée du peintre et ceci pour plusieurs raisons.
Les oeuvres que nous pouvons répertorier à l’heure actuelle n’en représentent qu’une petite partie, car beaucoup ont été vendues, soit du vivant du peintre, soit après sa mort. Les documents que nous possédons sur les ventes et expositions de son vivant sont relativement abondants et fiables de 1882 à 1900. Ils se raréfient après cette date. On peut leur faire confiance pour cette période, car si Henri ZUBER a toujours fait de l’aquarelle, jusqu’en 1882 il s’agissait surtout de petites œuvres et de pochades dont les nombreux carnets de croquis intitulés « Paris » (22 répertoriés) sont la preuve. Souvent ces pochades lui servaient à peindre, a posteriori, certaines de ses grandes aquarelles, en effet, rien ne nous dit qu’il installait son chevalet dans les rues de Paris ; il semble qu’il ait beaucoup travaillé en atelier, refaisant des œuvres similaires selon les goûts et les des demandes des amateurs de sa peinture.
 C’est à partir de 1880 qu’il commence vraiment à vendre ses aquarelles à des collectionneurs particuliers, comme Hartmann, et à exposer plusieurs oeuvres, par exemple à Londres par l’entremise de la Galerie Goupil and Co et, à partir de 1882, régulièrement chaque année jusqu’en1900 à l’exposition de la Société des Aquarellistes Français dont il devient membre. Durant cette période les aquarelles de Paris représentent, peu ou prou, le tiers ou la moitié, selon les années, de son œuvre aquarellée.
C’est à partir de 1880 qu’il commence vraiment à vendre ses aquarelles à des collectionneurs particuliers, comme Hartmann, et à exposer plusieurs oeuvres, par exemple à Londres par l’entremise de la Galerie Goupil and Co et, à partir de 1882, régulièrement chaque année jusqu’en1900 à l’exposition de la Société des Aquarellistes Français dont il devient membre. Durant cette période les aquarelles de Paris représentent, peu ou prou, le tiers ou la moitié, selon les années, de son œuvre aquarellée.
LES THÈMES DE LA PEINTURE D’HENRI ZUBER
 Les sujets des aquarelles de Paris de ZUBER sont variés ce sont d’abord les jardins, celui du Luxembourg, des Tuileries, du Parc Monceau, de l’Observatoire et de sa fontaine, mais aussi les alentours de l’ancien Trocadéro construit en 1868. Il aime aussi peindre les ponts et les places : Pont Marie, Pont de la Concorde, Pont Neuf et les places du Châtelet ou de la Concorde. Enfin, les boulevards animés de fiacres et de quelques personnages, les quais, la Seine parcourue de péniches et de « coches d’eau », avec de grands monuments comme le Louvre ou Notre Dame en premier plan. Henri Zuber ne représente pas souvent les monuments pour eux-mêmes, mais ils sont partie prenante d’un paysage urbain, avec son atmosphère d’une heure, d’un jour, d’une saison qui donne une évocation très variée de la lumière de l’Île de France que le temps soit froid ou sec un jour d’hiver, chargé de brumes légères un matin de printemps, ou gris et pluvieux, avec les reflets des flaques d’eau sur le sol, comme cela arrive si souvent à Paris.
Les sujets des aquarelles de Paris de ZUBER sont variés ce sont d’abord les jardins, celui du Luxembourg, des Tuileries, du Parc Monceau, de l’Observatoire et de sa fontaine, mais aussi les alentours de l’ancien Trocadéro construit en 1868. Il aime aussi peindre les ponts et les places : Pont Marie, Pont de la Concorde, Pont Neuf et les places du Châtelet ou de la Concorde. Enfin, les boulevards animés de fiacres et de quelques personnages, les quais, la Seine parcourue de péniches et de « coches d’eau », avec de grands monuments comme le Louvre ou Notre Dame en premier plan. Henri Zuber ne représente pas souvent les monuments pour eux-mêmes, mais ils sont partie prenante d’un paysage urbain, avec son atmosphère d’une heure, d’un jour, d’une saison qui donne une évocation très variée de la lumière de l’Île de France que le temps soit froid ou sec un jour d’hiver, chargé de brumes légères un matin de printemps, ou gris et pluvieux, avec les reflets des flaques d’eau sur le sol, comme cela arrive si souvent à Paris.
 De nombreuses œuvres ont été réalisées l’hiver, avec les stalactites de glace aux fontaines de la Place de la Concorde ou les plaques de neige sur le Boulevard Raspail. Souvent, des personnages sont là pour animer le sujet: ce ne sont pas des portraits, mais des silhouettes simplement esquissées qui signent l’œuvre en la mettant dans son temps. Ainsi sont représentées, les nounous aux tabliers blancs et aux longs rubans bleus qui leur tombent dans le dos depuis leur coiffe.
De nombreuses œuvres ont été réalisées l’hiver, avec les stalactites de glace aux fontaines de la Place de la Concorde ou les plaques de neige sur le Boulevard Raspail. Souvent, des personnages sont là pour animer le sujet: ce ne sont pas des portraits, mais des silhouettes simplement esquissées qui signent l’œuvre en la mettant dans son temps. Ainsi sont représentées, les nounous aux tabliers blancs et aux longs rubans bleus qui leur tombent dans le dos depuis leur coiffe.
Les petits enfants aux tenues désuètes jouent à leur côté ou près de dames, aux longues robes à pouf, qui abritent leur teint délicat sous de jolies ombrelles blanches. M.G.
Parfois, c’est une silhouette d’homme à la redingote sombre, coiffé d’un chapeau haut-de-forme, ou encore les cornettes de religieuses en promenade dans un jardin qui animent le sujet. Seuls, les premiers plans sont minutieusement peints, que ce soit les statues du Jardin du Luxembourg, le Palais du Louvre, les quais, un pont, ou une fontaine, tandis que la profondeur des lointains, le plus souvent esquissés, invite le regard à aller au-delà vers le ciel, les arbres et la ville. Ce n’est à aucun moment de la peinture de genre ; les aquarelles d’Henri ZUBER restent des paysages, paysages urbains, parisiens, certes où l’évocation de l’ombre et de la lumière, la couleur du ciel, la qualité même de la lumière à un moment donné comptent autant, sinon plus, que le lieu particulier du sujet. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, ses oeuvres sont restées si vivantes, contemporaines parfois, expression d’une ville, Paris.
Grand marcheur, Henri ZUBER parcourait Paris à la découverte de sensations nouvelles, portant avec lui « sa vieille boîte », dont il disait en écrivant à sa mère :
« Ah que je l’aime bien ! c’est une véritable amie qui m’a toujours été fidèle ; avec elle j’ai goûté de si beaux moments, de si chastes émotions… N’est-ce pas avec cette palette que j’ai appris à rêver devant une toile ? Ne lui suis-je pas redevable de tant d’heures passées dans un monde idéal qui prenait la place de l’ennuyeuse réalité ? ».